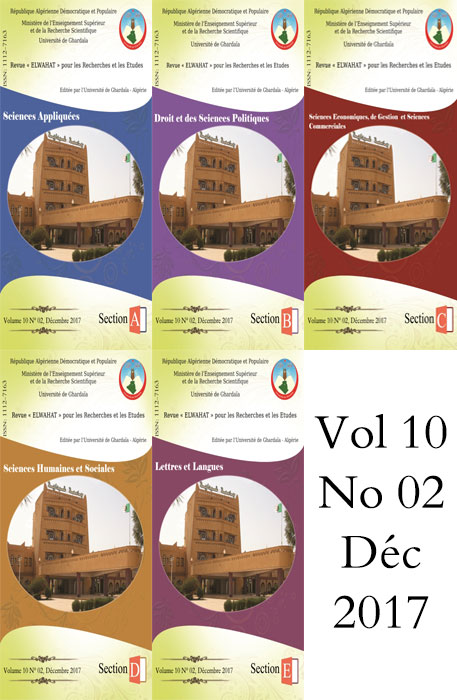De l’usage de la métaphorisation en sciences humaines et sociales : analogie, détour et/ou détournement de sens. Réflexions épistémologiques à partir de quelques phénomènes sociolinguistiques perçus en Algérie.
Abstract
L’auteur tente de défendre l’idée que les usages métaphoriques sont certes d’une importance capitale dans le champ des sciences humaines et sociales (SHS). Il en prend pour exemple le champ de la sociolinguistique, discipline pleinement anthropolinguistique, pour explorer quelques métaphores y circulant et les soumettre à un questionnement épistémologique. Celui-ci permet de montrer, entre autres, que les déplacements de sens ne sont pas nécessairement salutaires et seraient même heuristiquement d’un certain risque de routinisation voire de dogmatisation si aucune entreprise de distanciation et de renouvèlement critique n’était menée pour filtrer justement les exercices analogiques de leur sédimentation conceptuelle.
Mots clés -
Métaphorisation - phénomènes sociolinguistiques - épistémologie – sens
References
Ces observations ont été conduites dans le cadre de notre doctorat intitulé (Becetti, 2012) « approches sociolinguistiques des répertoires verbaux des jeunes algériens : pratiques et représentations » et dont s’inspirent en grande partie, les remarques de cet article.
On voit bien ici qu’on ne saurait échapper, en fait, à la métaphorisation non seulement en tant que procédé descriptif ou outil explicatif mais aussi en tant que procédé rhétorique puisqu’en l’évoquant, nous avons parlé du «contact », qui serait une autre métaphore qui circule dans le champ sociolinguistique, en particulier (cf. Tabouret-Keller, 2008).
ROBILLARD de, D., 2007, « La linguistique autrement : altérité, expérienciation, réflexivité, constructivisme, multiversalité : en attendant que le Titanic ne coule pas » in Carnets d’atelier de sociolinguistique N°1, pp 01-149. http://www.upicardie.fr/LESCLaP/spip.php?rubrique55. (20/09/2010).
BLANCHET, Ph., 2002, Langues, cultures et identités régionales en Provence. La Métaphore de l’aïoli, Paris, L'Harmattan.
MOREAU, M-L (éd.), 1997, Sociolinguistique, concepts de base, Mardaga, pp.204.
CALVET, L-J., 2007, « Pour une linguistique du désordre et de la complexité », in Carnets d’atelier de sociolinguistique N°1, pp 18. http://www.upicardie.fr/LESCLaP/spip.php?rubrique55. (20/09/2010)
Calvet, L-J, ibid. p. 51.
ROBILLARD, D. (de), 2001a, « Peut-on construire des « faits linguistiques » comme chaotiques ? Quelques éléments de réflexion pour amorcer le débat ». Marges Linguistiques.1, p.12 (www.margeslinguistiques.com).
LICHNEROWICZ, A., PERROUX, F., & GADOFFRE, G., (dir.), 1980, Analogie et connaissance. Tome I - Aspects historiques. Paris, Maloine.
DE COSTER, M., 1978, L'analogie en sciences humaines. Paris, PUF.
BUSINO, G., 2003, « La place de la métaphore en sociologie », Revue européenne des sciences sociales [En ligne], XLI-126, pp.91.URL : http://ress.revues.org/539
BLANCHET, Ph., 2003, « contacts, continuum, hétérogénéité, polynomie, organisation « chaotique », pratiques sociales, interventions… quels modèles ? pour une (socio)linguistique de la ‘‘complexité’’ », dans BLANCHET, PH., & ROBILLARD, D. de, (éd.) Langues, contacts, complexité. Perspectives théoriques en sociolinguistique, Cahiers de Sociolinguistique n°8, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 299-300.
CORCUFF, Ph, 2011, «Présupposés anthropologiques, réflexivité sociologique et pluralisme théorique dans les sciences sociales », revue Raisons politiques. Études de pensée politique n°43, pp.197.
Corcuff, ibid.
Passeron, ibid. p.20.
GASQUET-CYRUS, M., & CÉCILE PETITJEAN, C.,(dir.), 2009, Le poids des langues. Dynamiques, représentations, contacts, conflits, Paris, L’Harmattan, coll. « Espaces Discursifs ». cette publication fait suite à un colloque tenu à Aix-en-Provence en septembre 2007 sur la question des poids des langues et dont les actes ont été réunis sous la direction de Gasquet-Cyrus & Petit-Jean (2009) demeure, à nos yeux, le seul événement scientifique qui ait explicitement été dédié à cette problématique et cela, même si l’Observatoire de la langue française, en 2008, a essayé de discuter des modalités d’observation du français dans le monde en ayant un regard critique sur la valeur et le poids des langues.
BLANCHET, Ph., 2004, « L’identification sociolinguistique des langues et des variétés linguistiques : pour une analyse complexe du processus de catégorisation fonctionnelle », MIDL, Paris, pp. 31-36.
BULOT, Th., & BLANCHET, Ph., 2008, « Propositions pour une analyse glottonomique de la complexité des situations sociolinguistiques francophones », dans Séminaire international sur la méthodologie d’observation de la langue française dans le monde, AUF, Paris, pp.130.
CHAUDENSON, R. & RAKOTOMALALA, D., 2004, Situations linguistiques de la Francophonie, AUF.
CALVET, L-J, 2008, « Le poids des langues : Vers un « index des langues du monde » et les éventuelles applications régionales de ce projet », dans Séminaire international sur la méthodologie d’observation de la langue française dans le monde, AUF, Paris, p.37.
BECETTI, A., 2012, Approches sociolinguistiques des répertoires verbaux des jeunes algériens : pratiques et représentations, Thèse de doctorat, ENS, Alger.
CALVET, L.-J., 2004, Essais de linguistique. La langue est-elle une invention des linguistes ?, Paris, Plon.
BLANCHET, Ph., 2009, «Gravité et relativité du pesage des langues : avantage, inconvénients et limites d’une métaphore », dans GASQUET-CYRUS, M., & PETITJEAN, C., (dir.), Le poids des langues, pp.81.
ROBILLARD, D. (de), 2001b, « En lizje kokê patat ên lizje vej gardjê* ? La linguistique peut-elle passer « entre les langues » ? Exemples de contacts français/créoles à la Réunion », Cahiers d’études africaines, n°163, pp. 465-496.
BLANCHET, Ph., CALVET, L-J. & ROBILLARD, D. (de), 2007, Un siècle après Saussure : la linguistique en question, Carnets D’Atelier de Sociolinguistique, n°1, L’Harmattan.
TABOURET-KELLER, A., 2009, « La métaphore du poids est-elle pertinente pour traiter de la langue? », dans GASQUET-CYRUS, M., & PETITJEAN, C., (dir.), Le poids des langues, Paris, L'Harmattan, Coll. Espaces discursifs, pp. 39-40.
PIEROZAK, I., 2009, « Le « poids » des langues sur internet. La revanche des « poids plume » ? », dans GASQUET-CYRUS, M., & PETITJEAN, C., (dir.), Le poids des langues, Paris, L'Harmattan, Coll. Espaces discursifs, pp. 293.
Soulignement de l’auteur lui-même.
ROBILLARD, D. (de), 2005, « Quand les langues font le mur lorsque les murs font peut-être les langues : Mobilis in mobile, ou la linguistique de Nemo », in Revue de l’Université de Moncton, vol. 36, no 1, 2005, pp.133.
Cela même si l’on avait bien conscience que ces (variétés de) langues étaient en contact, générant des formes complexes, comme celles ayant été observées entre l’arabe dialectal et le français. D’où, d’ailleurs, notre prudence scrupuleuse à ne pas escamoter les phénomènes de contact qui en résultent en préférant les intégrer dans un couple variétal arabe dialectal/français, certes, ambigu, mais qui permet, en revanche, de référer justement aux mélanges qui se produisent.
PRUDENT L-F, 1981, « Diglossie et interlecte », Langages, Vol.15, N° 61, pp. 13 – 38.
Blanchet, Ph., Ibid.81.
BILLIEZ, J. & MILLET, A., 2001, "Représentations sociales : trajets théoriques et méthodologiques" Les représentations des langues et leur apprentissage. Références, modèles, données et méthodes, ss.dir. MOORE, Paris: Didier, pp.31-49.
BLANCHET, Ph., 2008, «La nécessaire évaluation des politiques linguistiques entre complexité, relativité et significativité des indicateurs», dans Les Cahiers du GEPE, N°1, en ligne sur : http://www.cahiersdugepe.fr/index898.php (23/10/11).
HOUDEBINE A.-M., 1991, « La dilution de l’Objet », Où en sont les sciences du langage dix ans après ? BUSCILA, Paris, 55.
CALVET, L.-J., 1999, Pour une écologie des langues du monde, Plon, Paris.
FREI, H., 1929La Grammaire des fautes, Paris, Slatkine.
ANCORI, B., 2005, « « Analogie, évolution scientifique et réseaux complexes », dans Nouvelles perspectives en sciences sociales : revue internationale de systémique complexe et d'études relationnelles, Vol. 1, n° 1, pp. 56.
Une énumération des recherches qui traitent du CS serait, sans doute, ici de trop tant elles sont abondantes. La bibliographie qui figure en fin de cette recherche peut donner une idée de cette profusion scientifique sur la question.
KLINKENBERG, J-M., 2000, Précis de sémiotique générale. De Boeck Université.p.64
ALVAREZ-CÁCCAMO, C., 1998, « From “switching code” to “codeswitching”: Towards a reconceptualisation of communicative codes », In P. Auer (Ed.), Codeswitching in conversation, London: Routledge., pp. 29–50.
CASTELLOTTI, V., 2011, « Alternances, parlers plurilingues, interlecte ? Quelle(s) terminologie(s) pour quelle(s) conception(s) de la pluralité ? in Langues et cité, Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques, n° 17, pp.4-5.
LE DU, J., & LE BERRE, Y., 1990, « Langue et institutions. A propos du breton » dans PULA N° ¾, Les langues polynomiques, Université de Corse, p.291.
AUER, P., 2007, « The monolingual bias in bilingualism research, or: why bilingualism is (still) a challenge for linguistics», in: M. Heller (dir.), Bilingualism: A social approach, Houndmills: Palgrave, pp. 319-339.
POLACK, S., 1980, “Sometimes I'll start a sentence in Spanish Y TERMINO EN ESPAÑOL: toward a typology of code-switching.”, Linguistics 18, pp. 581-618.
Alvarez-Cacàmo, ibid. p.36.
BECETTI, A., 2011, « Quelques exemples de contacts français/arabes à Ténès. Gad youdjadou fi nahri mala youdjadou fi lbahri» : français, arabe, « francarabe » ou ce qu’une approche « émique » peut donner à penser à la linguistique. », Annales de l’Université de Craiova, Series Philology, Linguistics, ANUL XXXIII, N°1/2, p. 46.